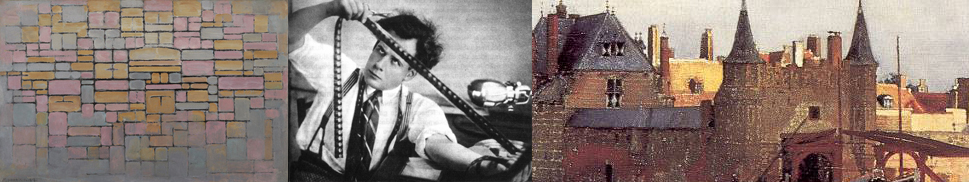Membres |
Doctorants
Nathalie Sebayashi

Coordonnées professionnelles
Sujet de thèse: «L'appropriation des images. Les albums factices et les usages des documents visuels imprimés en France, 1830-1899».
Sous la direction de André Gunthert et J.M. Schaeffer
Les premières gravures sur bois sont dès leur origine utilisées en tant qu'«extra-illustration» à récupérer (échange, achat), amasser, sélectionner et coller pour illustrer des livres manuscrits (exemple du recueil d'Anna Jäck, datant de la seconde moitié du XVe siècle).
Dès le dernier tiers du XVe siècle toutes les manières de s'approprier l'image imprimée sont déjà présentes : collées dans les intérieurs de maison, dans les meubles ou coffrets (images de préservation), utilisées dans la ville lors de fêtes, de processions, pèlerinages, etc. présentes dans le livre imprimé et se ménageant une place de plus en plus établie au sein de la page, elles sont de type religieux, décoratif, instructif, etc. Les typologies ne manquent pas pour tenter d'embrasser la masse énorme de ces artefacts. En revanche, nous ne savons que peu de choses sur leur usage réel, l'image populaire ne correspond pas à l'«homme populaire», de même que l'usager type de l'image imprimée n'existe pas. En effet, l'image imprimée, quand elle nous parvient, demeure incomplète car si nous pouvons voir ce qu'elle représente, il nous manque son contexte de création et de diffusion, sa réception et enfin son usage. Nous voyons l'image mais ne pouvons la comprendre entièrement sans ces éléments.
En ce qui concerne notre étude, nos objets de réflexion sont des albums blancs, fabriqués pour l'occasion ou achetés tels quels, dans lesquels sont collées des images imprimées, nous les appelons «albums factices» (album : livre blanc relié) ou pour reprendre un terme en usage parmi les bibliothécaires, «recueil factice», qui désigne les ouvrages constitués de documents manuscrits ou imprimés, reliés ensemble ou collés page après page à des fins de conservation et de consultation. Cette pratique date également du XVe siècle, si l'on prend pour exemple les albums montés par les collectionneurs d'estampes et de dessins. Et les questionnements relatifs à l'image imprimée, que nous avons avons exposés plus haut, s'appliquent aux albums factices d'images à ceci près qu'ils nous permettent de voir et d'envisager certains aspects du contexte et surtout de l'usage de l'image imprimée : dans l'album les images sont souvent découpées, voire détourées, mises en page et collées en fonction des dispositions et des moyens de l'usager.
Cette entreprise nous a amené à considérer les nécessaires actions qui ont donné lieu à la constitution et la fonction performative de l'album : la chasse aux images, leur accumulation, la sélection, les mises en page et le collage (dans un cadre solitaire ou bien familial), ainsi que plus tard le légendage oral de l'album, sa mise en récit. Utiliser l'image imprimée est un moyen efficace de produire un récit visuel pour une personne qui ne peut (ou ne veut) ni dessiner, ni payer quelqu'un pour le faire.
Ces pratiques de montage d'album n’ont pas disparu avec les développements de l’imprimerie et les apparitions puis démocratisation des premières encyclopédies visuelles imprimées, bien au contraire. Elles sont demeurées pour le particulier un moyen simple de fabriquer ses propres livres d’images, d'organiser un récit visuel. Toutefois les contours de cette pratique (accès au livre, aux images imprimées, temps et budget adéquat, degré d'acculturation) conduisent à penser que cet usage demeure réservé à des personnes pouvant disposer facilement de moyens pour leurs occupations domestiques. Ces limites se distendent vers le milieu du XIXe siècle – améliorations et diversification des techniques d’impression, développement des voies de chemin de fer, abaissement des coûts de vente et mise en place d’une pensée industrielle de la production/consommation. L’image imprimée est partout et sous différentes formes et prix. Les politiciens de la Monarchie de Juillet et de la Deuxième République la portent aux nues et la mettent en pratique par le biais de lois l'alphabétisation des Français, ils sensibilisent les parents à l’importance de l’éducation des enfants. En outre, de nouvelles figures de collectionneur/ consommateur culturel – la femme et l’enfant – permettent aux producteurs de ménager de nouveaux marchés, d’inventer de nouvelles formes éditoriales (chromos, découpis) et de nouvelles stratégies (images publicitaires gratuites).
Les albums factices sont le témoin d’appropriation de l'image imprimée par le découpage (les images sont toutes découpées en fonction de leur nature ou provenance, souvent émargées) ; la mise en page (en fonction de la nature et de la taille de l’image, optimisation de l'espace); et le collage (bavures, traces, gouttes ou netteté chirurgicale sont autant d’indices lisibles permettant de traduire les manières de faire d’un amateur). Ces pratiques conjuguées de la collecte et du montage dans un album constituent des vogues très populaires et répandues en France comme en Europe, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Cependant l’histoire matérielle de ces arts de faire4 reste largement méconnue, peu d’albums ayant survécu à leur compilateur et les usages ordinaires de l’image imprimée étant peu étudiés sous cet angle. Analyser les traces laissées par le collecteur est un moyen d’observer les pratiques d’un consommateur, et peut permettre de poser des questions encore pertinentes actuellement sur nos appropriations de l'image.
 Actualités
Actualités
Miró Matisse
 Exposition - Vendredi 28 juin 2024 - 10:00La Fundació Joan Miró à Barcelone et le musée Matisse à Nice s’associent pour organiser une exposition consacrée aux rapports entre les oeuvres d’Henri Matisse et de Joan Miró. À première vue, le rapprochement entre les deux artistes peut sembler surpren (...)(...)
Exposition - Vendredi 28 juin 2024 - 10:00La Fundació Joan Miró à Barcelone et le musée Matisse à Nice s’associent pour organiser une exposition consacrée aux rapports entre les oeuvres d’Henri Matisse et de Joan Miró. À première vue, le rapprochement entre les deux artistes peut sembler surpren (...)(...)
Coline Desportes, doctorante de l'EHESS, récipiendaire du Grand Prix Marcel Wormser 2023
Prix et distinctions -Le Prix Marcel Wormser récompense chaque année les travaux de chercheurs – étudiants, professionnels ou amateurs – sur la traçabilité des biens culturels.La première édition du Prix Marcel Wormser, créé par l’association Astres, a couronné deux lauréates : un Grand Prix (do (...)(...)
Hubert Damisch y los trabajos del arte
 Colloque - Jeudi 23 novembre 2023 - 09:30El empeño de Hubert Damisch (1928-2017) por constituir un espacio de interrelación entre la historia del arte y el conjunto de la humanidades tuvo como consecuencia inmediata la fundación del Centro de Historia y Teoría del Arte (CEHTA) de París. Integrad (...)(...)
Colloque - Jeudi 23 novembre 2023 - 09:30El empeño de Hubert Damisch (1928-2017) por constituir un espacio de interrelación entre la historia del arte y el conjunto de la humanidades tuvo como consecuencia inmediata la fundación del Centro de Historia y Teoría del Arte (CEHTA) de París. Integrad (...)(...)
Centre d'Histoire et de Théorie de l'Art
Institut National d'Histoire de l'Art
Espace Rotonde. Bureaux 140, 141, 142
2 rue Vivienne, 75002 Paris
Direction : Giovanni CARERI
giovanni.careri@ehess.fr
Tél. : +33 (0)1 47 03 85 42
Emanuele COCCIA
emanuele.coccia@ehess.fr
Rémi LABRUSSE
rémi.labrusse@ehess.fr
Ingénieure d'études: Sabine GUERMOUCHE
s.guermouche@ehess.fr
Tél. : +33 (0)1 47 03 85 42